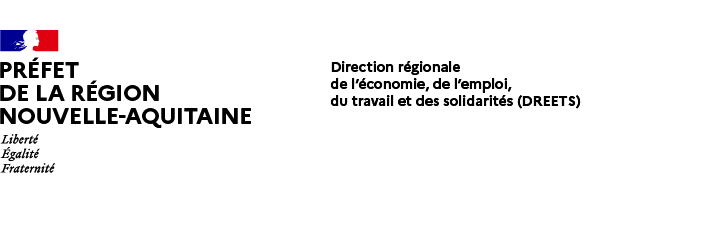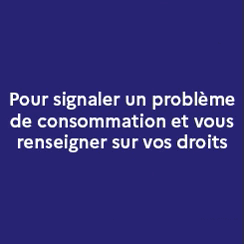Économie de la fonctionnalité et droit de la consommation
Publié le 8 octobre 2025 | Dernière mise à jour le 21 octobre 2025

À la suite de l’avis du Conseil national de la consommation sur le « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité » et pour accompagner le développement des offres s’inscrivant dans ce modèle économique, cette fiche pratique, en premier lieu destinée aux professionnels souhaitant s’engager sur cette voie, rappelle le cadre juridique applicable afin d’assurer la bonne information des consommateurs, et ce faisant de contribuer à l’attractivité de ce nouveau modèle.
L’essentiel :
- L’économie de la fonctionnalité implique des services proposés par le professionnel dans le cadre d’une offre de solutions adaptées aux besoins définis au plus juste plutôt que la propriété d’un produit.
- L’économie de la fonctionnalité se distingue du concept de location, car elle s’inscrit dans une perspective d’engagement à long terme avec une dimension environnementale et sociale.
- Le consommateur doit bénéficier d’informations précontractuelles claires et complètes. Avant la conclusion du contrat, il doit ainsi être informé sur les prix, les caractéristiques essentielles du service ou du bien, les qualités de la prestation et les conditions de sa fourniture, les dispositions assurant le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).
- Le professionnel doit présenter les impacts environnementaux ou sociaux de l’offre, de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs.
Qu’est-ce que l’économie de la fonctionnalité (et de la coopération) - EFC ?
L’économie de la fonctionnalité n’a pas de définition juridique (la notion est toutefois mentionnée au sein de l’article L. 541-1 du code de l’environnement parmi d’autres notions correspondant aux bonnes pratiques à mettre en œuvre pour la « commande publique durable »). À la différence des modèles de consommation plus traditionnels fondées sur l’acquisition d’un bien, le consommateur qui conclut un contrat d’EFC ne devient généralement pas propriétaire du bien, mais obtient un droit d’usage ou achète une prestation de services rendue à l’aide de ce bien (ou une offre intégrée de biens et de services). L’EFC implique des services proposés par le professionnel (ou par un groupement de professionnels) dans le cadre d’une offre de solutions adaptées aux besoins définis au plus juste plutôt que la propriété d’un produit, permettant de limiter les impacts environnementaux. Le contrat d’EFC est ainsi considéré, au regard du code de la consommation, comme un contrat de service intégrant l’usage d’un bien et non comme un contrat de location.
- Un exemple classique distingue des offres de location « simple » de voiture ou de vélos, qui ne relèvent pas de l’EFC, et des services plus complets qui visent à accompagner l’usager dans ses mobilités, au moins par une adaptation et une souplesse de l’offre en fonction de ses usages (exemple : possibilité de changer de type de véhicule), par des services facilitant l’utilisation (exemple : maintenance, réparation, conseil), voire par une prise en charge plus complète (exemple : analyse du déplacement, solutions de mutualisation pour réduire l’impact environnemental, couplage avec des titres de transport, etc.)
Ainsi, Il s’agit d’un changement de paradigme qui marque le passage d’un « régime de propriété » à un « régime d’accès » (Rifkin, 2000). Nonobstant le caractère protéiforme des offres s’inscrivant dans ce schéma, elles présentent toutefois un dénominateur commun : l’usage ou la fonctionnalité, voire la performance d’usage, plus que la propriété. On parle d’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) lorsque la mise en place de la solution centrée sur l’usage repose sur une coopération entre acteurs pour définir le besoin en termes de fonctionnalités, mais aussi parfois pour atteindre de manière plus efficace des objectifs de durabilité tant pour l’utilisateur que pour l’industriel ou pour des tiers. En intégrant dans le service la définition du besoin, l’ajustement en continu de l’offre selon des critères de performance, la maintenance et la gestion de la fin de vie du produit, il incite à l’écoconception des produits et permet un allongement de leur durée de vie et d’usage, avec des bénéfices de compétitivité comme de réduction de l’impact environnemental.
Quelles différences avec la location ?
Selon le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), « l’économie de la fonctionnalité se distingue du concept de location, car elle s’inscrit dans une perspective d’engagement à long terme avec une dimension environnementale et sociale » (voir la présentation du SGPE au CNEC du 13 juillet 2023). L’EFC est notamment orientée vers des bénéfices environnementaux, notamment pour réduire la consommation de biens et de ressources. Elle implique de prendre en compte la performance y compris sous l’angle environnemental et d’éviter l’annulation de certains gains environnementaux, obtenus par une gestion des ressources plus efficace ou des évolutions techniques, par une augmentation de la consommation ou une modification des usages (effets « rebonds »). Cela implique aussi une perspective d’engagement à plus long terme que la plupart des offres de location.
De même, les locations avec option d’achat ne s’inscrivent a priori pas dans l’économie de la fonctionnalité, d’une part parce qu’elles peuvent conduire à l’achat des biens, et donc s’inscrire dans la logique de maximisation des volumes propre à l’économie de la propriété, d’autre part parce qu’elles peuvent conduire à une limitation dans le temps de l’offre servicielle (les entreprises pouvant avoir intérêt à transférer la propriété au consommateur avant la survenue des premières pannes) (sur l’encadrement de ces pratiques, voir https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/laction-de-la-dgccrf/les-enquetes/contrats-de-location-avec-option-dachat-focus-sur-les). En revanche, certaines offres d’EFC peuvent prendre la forme de locations enrichies d’autres services. Il convient donc de distinguer la location simple de la location avec des services associés et visant une réduction des impacts environnementaux, qui relève de l’économie de la fonctionnalité.
Réglementation applicable en matière d’information précontractuelle
L’obligation d’information précontractuelle constitue l’un des critères fondamentaux de la protection des intérêts économiques des consommateurs et ce faisant de la loyauté des transactions. Elle est encadrée par les articlesL. 111-1 et suivants du code de la consommation pour les contrats en établissement et l’article L. 221-5 du même code (sauf pour les contrats entrant dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 221-2 pour lesquels les dispositions VAD/VHEC ne s’appliquent pas. Ainsi le professionnel n’est pas tenu de communiquer au consommateur les informations prévues à l’article L. 221-5 (et le droit de rétractation ne s’applique pas non plus) pour les contrats conclus à distance ou hors établissement.
- Caractéristiques essentielles du service
Assurer cette information avant la conclusion d’un contrat conclu avec un consommateur ou avec un non-professionnel suppose de définir préalablement les caractéristiques essentielles de ce service. Si les caractéristiques essentielles ne sont pas définies par la loi (sauf précisions apportées par la réforme de 2021 pour les contrats de fourniture de contenu et services numériques) , on peut considérer que sont couvertes aussi bien la description des qualités de la prestation que les conditions de sa fourniture. Le professionnel doit communiquer les informations relatives aux caractéristiques dont les consommateurs ont besoin pour s’engager en connaissance de cause (la jurisprudence a par exemple considéré que les risques encourus par le consommateur dans l’utilisation du produit font parties des caractéristiques essentielles). En particulier, les consommateurs doivent être informés de l’ensemble des caractéristiques essentielles des produits dont l’utilisation est proposée ainsi que les limites à leur emploi et auxquelles le consommateur moyen ne saurait s’attendre, car celles-ci sont particulièrement susceptibles d’influencer sa décision commerciale. C’est notamment le cas pour les restrictions d’usage.
Le groupe de travail du CNC permet d’identifier certains items incontournables (rapport CNC – partie 6.1) pour définir l’offre proposée aux consommateurs :
- la fonction et l’usage d’un bien impliqué dans l’offre ;
- les informations utiles sur la facilité d’accès et la disponibilité des biens ;
- la temporalité du service (réflexion à plus ou moins long terme en fonction des besoins) ;
- le niveau de fiabilité, de performance, d’efficacité de l’offre ; en particulier, une attention particulière est attendue sur les informations permettant d’éviter les mésusage, les modalités prévues en cas de non-fonctionnement (défaut, panne…).
La DGCCRF considère en outre que l’existence d’une offre de maintenance intégrée dans l’offre globale, les cas échéant les services optionnels associés, les conditions pour assurer les reprises ou changements d’équipements lorsque c’est nécessaire, et l’existence d’une assurance comprise ou non dans l’offre globale, la possibilité d’une évolution des prestations en cours de contrat constituent également des caractéristiques essentielles de l’offre d’EFC. Compte tenu du risque de confusion entre l’offre principale et des éventuels contrats d’assurance qui lui seraient rattachés, la diffusion d’une information spécifique à ces derniers est indispensable.
D’autres éléments procèdent davantage de la définition du modèle d’EFC que des caractéristiques précises du contrat proposé au consommateur, et, sans relever de l’information précontractuelle obligatoire, peuvent être utiles à préciser la définition de l’offre, en particulier si la performance environnementale est mise en avant :
- la réduction des impacts environnementaux ;
- la qualité et la durabilité des biens impliqués dans l’offre ;
- la prise en compte de l’ensemble de la chaine de valeur et des externalités positives ou négatives dans la fixation des prix, voire la participation de tiers (cobénéficiaires) au financement du modèle économique.
- Respect du RGPD
Les modalités de traitement (collecte et utilisation) de données à caractère personnel constituent également des informations essentielles pour le consommateur. Le droit d’opposition à l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection commerciale est également à rappeler, une bonne pratique étant par ailleurs d’inclure une demande de consentement exprès et d’exclure toute collecte et utilisation postérieurement à la résiliation du contrat. Pour plus d’informations, voir le site de la CNIL.
Une attention particulière doit être portée aux contrats d’assurance complémentaires (sur les risques de ces pratiques : voir https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/abonnements-caches-ou-assurances-liees-comment-les-eviter-et-sen).
- Information sur les prix
Avant la conclusion du contrat, le consommateur est également informé du prix du service d’EFC (Art. L. 111-1 ou L. 221-5 du code conso). Il peut arriver qu’il ne puisse pas être calculé à l’avance dans la mesure où il peut dépendre de l’usage du consommateur voire d’un niveau de performance atteint. Si c’est le cas, il convient en revanche que le consommateur soit informé du mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, de tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels conformément à l’article L. 112-3 du code de la consommation. Si c’est le cas, la possibilité d’évolution des prix en fonction de l’évolution des prestations, en cours d’abonnement doit être clairement mentionnée. Une bonne pratique identifiée est de distinguer dans le contrat les charges de maintenance/réparation inclus dans le contrat et celles liées aux éventuels achats de consommables.
Le coût d’éventuelles franchises en cas de casse du bien doit également faire l’objet d’une information dédiée. Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais (Art. L. 221-6 du code de la consommation).
Si le contrat est à durée indéterminée, ou pour les contrats d’abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chacune des périodes de facturation ou s’ils ne peuvent être connus, leur mode de calcul est communiqué conformément à l’article L. 112-4 du code de la consommation.
- Droit de rétractation
Si le contrat d’EFC (pour les contrats qui ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article L. 221-2 du code de la consommation) est conclu à distance, le droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation s’applique sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 221-28 du même code.
A quoi doit veiller le professionnel ?
- Attention aux mentions trop valorisantes !
Toute présentation du service, au titre de l’information précontractuelle ou via des supports de communication (brochure ou site web sur la promotion de l’EFC), notamment sur les impacts environnementaux ou sociaux de l’offre doit être présentée de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs. Pour mémoire, une allégation environnementale peut aussi être trompeuse si elle induit en erreur, ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen par le biais d’informations factuellement correctes. L’allégation ne doit jamais laisser penser que le produit (bien ou service) n’a pas d’impact sur l’environnement, ni a fortiori qu’il a un impact positif. Les professionnels doivent disposer de preuves à l’appui de leurs allégations (c’est-à-dire fondées sur des preuves scientifiques et des méthodes reconnues).
De la même manière, si la communication met en avant une économie financière pour les consommateurs qui choisiront l’EFC vis-à-vis d’un achat classique de bien ou vis-à-vis d’offres concurrentes, celle-ci doit être étayée et ne pas induire en erreur les consommateurs sur la réalité du gain escompté.
En tout état de cause, ce contrat est soumis aux dispositions qui sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-2 du code de la consommation).
- Attention aux clauses abusives !
Quand le contrat est proposé à un consommateur (ou à un non-professionnel), il faut veiller à proscrire les clauses abusives des conditions générales telles qu’elles sont définies aux articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.
Parmi les plus problématiques figurent notamment :la clause autorisant le professionnel à modifier la durée du contrat, ses caractéristiques ou son prix ;
- celle qui prévoit que seul le professionnel peut déterminer si le service fourni était bien conforme au contrat ;
- celle qui exclut l’application de tout droit conféré par la loi (garantie légale ou recours juridictionnel).
En cas de contrôle, des amendes pourraient être prononcées (art. L. 241-2 du code de la consommation)
- Attention au type de contrat : CDD ou CDI et mode de résiliations associés
De façon classique en matière de contrat de service, la durée d’engagement du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation, sont également des éléments qui entrent dans l’obligation d’information précontractuelle (et le cas échéant celles spécifiques aux contrats d’assurances associés, à distinguer clairement).
Quand le contrat est conclu pour une durée indéterminée, ce qui peut être fréquemment le cas des contrats de services, le professionnel peut lui apporter des modifications tenant à son contenu ou à son prix. Cependant, il doit en avertir le consommateur suffisamment en amont afin qu’il puisse refuser et opter pour la résiliation.
En cas de contrat conclu pour une durée déterminée, les modalités de résiliation doivent être détaillées au contrat et identiques pour les parties. Le professionnel ne peut pas prévoir des conditions plus restrictives pour le consommateur que pour lui-même (délai de préavis plus long par exemple).
- En cas de dysfonctionnement du bien, quelles modalités sont prévues et quelle adaptation l’EFC propose concernant le service client ?
La garantie du bon fonctionnement de la prestation offerte (bien et service) dans le cadre de l’EFC contribuera grandement à la confiance des consommateurs et ce faisant au développement sur le marché de ce type de modèle mais ce type de garantie reste facultatif et relève du libre choix du professionnel.
Le professionnel reste en tout état de cause responsable des dysfonctionnements du bien mis à disposition du consommateur (hors hypothèse de dégradation volontaire par exemple). Pour rappel, les clauses d’exonération de responsabilité du professionnel en toute circonstance sont abusives et en conséquence doivent être exclues. Dans la même logique, les clauses qui prévoient que le matériel loué est réputé en bon état de fonctionnement sont interdites (« clauses noires »). En effet, au regard de l’article 1353 du code civil, il revient au professionnel de prouver le respect de son obligation de délivrance d’une chose conforme à l’usage locatif attendu. Ainsi, la Commission des clauses abusives (Recommandation n° 20-01 relative aux contrats de location de moyens de transports individuels en libre-service) a estimé que les clauses précitées, en ce qu’elles présument le respect de l’obligation de délivrance d’une chose conforme à l’usage locatif attendu, ont pour objet d’imposer au consommateur la charge de la preuve de la non-conformité à l’usage et, ce faisant, sont irréfragablement présumées abusives en application de l’article R. 212-1, 12° du code de la consommation. L’EFC impliquant l’usage du bien et non sa propriété, le professionnel doit tout mettre en œuvre pour que le consommateur puisse bénéficier de l’usage.
Les dispositions sur l’information quant à la date d’exécution restent applicables à la prestation de service rendue dans le cadre du contrat d’EFC (à défaut d’information, la prestation doit être rendue dans un délai de 30 jours maximum à compter de la conclusion du contrat). En cas de manquement à l’obligation de fourniture de la prestation de service, les options de résolution du contrat sont régies par l’article L. 216-6 du code de la consommation.
- Quid de la sécurité des produits ?
Pour les produits dont le cadre juridique est harmonisé au niveau européen (ex : jouets, équipements de protection…), la règlementation en matière de sécurité est applicable aux produits au moment de leur mise sur le marché, mais pas aux produits d’occasion qui restent néanmoins soumis à l’obligation générale de sécurité. Un produit mis à disposition d’un consommateur doit rester sûr au regard des conditions d’usage raisonnablement prévisibles et sur sa durée de vie. Le professionnel de l’économie de la fonctionnalité doit donc anticiper ces conditions d’usage, ce qui lui est normalement accessible étant donné que son offre est construite pour répondre à des usages bien identifiés. Dans les versions les plus abouties d’EFC, une véritable reconception du produit voire du service est réalisée pour répondre aux besoins de l’EFC, ce qui permet également d’inclure les industriels et fabricants.
Voies de recours
En cas de litige lié à une offre EFC, l’ensemble des recours habituels est mobilisable par les consommateurs. Les professionnels doivent en particulier afficher les coordonnées du médiateur dont ils relèvent (dans les conditions prévues par l’art. L. 616-1 du code de la consommation) Ces coordonnées seront également délivrées au consommateur si une réclamation n’a pas pu se régler avec le professionnel.
En résumé
Le contrat prévoit de manière claire :
- les biens ou les services fournis ainsi que leurs conditions et restrictions d’usage ;
- les éventuelles obligations d’entretien ;
- le prix à payer en une fois ou de façon échelonnée (attention aux abonnements cachés) ;
- les options qui peuvent être souscrites moyennant paiement supplémentaire ;
- la durée du contrat (fixe ou indéterminée) ;
- les conditions de modifications contractuelles ou de résiliation du contrat ;
- les clauses qui concernent la gestion des pannes ;
- les éventuelles garanties (légales, commerciales) ou les assurances proposées.
Grille d’autoévaluation des professionnels en matière d’économie de la fonctionnalité
Indépendamment de la conformité au droit de la consommation, et afin de mieux accompagner les professionnels dans l’appropriation de ce modèle économique et l’identification de leurs marges de progression, une grille d’autoévaluation est mise à leur disposition.
Grille d’autoévaluation des professionnels en matière d’économie de la fonctionnalité - XLSM, 50 Ko et notice méthodologique associée
En savoir plus :
Avis relatif au développement et à la sécurisation de l’économie de la fonctionnalité - Conseil national de la consommation